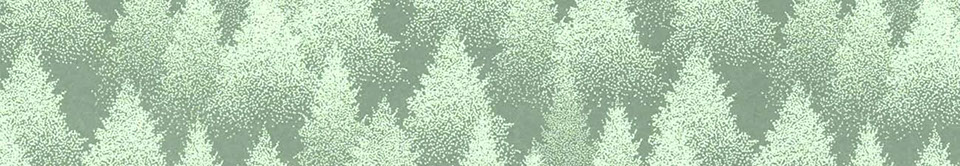
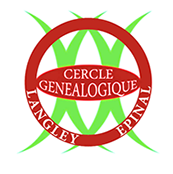

LE GARGANTUA DE ROCHESSON
CLAUDON Jean-Jacques, surnommé Jacques Févat, vivait en 1750, il était né à Rochesson, canton de Saulxures, à quelque distance de la magnifique cascade du Bouchot. La nature l’avait doué d’une stature colossale, d’un tempérament robuste, d’une force herculéenne. À ces qualités physiques, que l’industrie manufacturière a détruit de nos jours dans les montagnes où elle s’est fixée, Claudon réunissait le sentiment d’un besoin incessant de manger. Son appétit insatiable désolait et ruinait sa famille ; on l’eût dit aiguillonné par le dard du ténia. La plupart du temps, Claudon condamnait ses parents à une sobriété forcée ; il consommait sans façon et sans peine la plus grande partie de leurs provisions annuelles ; si bien qu’ils se virent obligés de le nourrir à part et de prendre leurs repas en son absence et à son insu, dans la crainte d’être privé par lui de leurs vivres et d’être exposés à une diète continuelle.
Le Pantagruel de Rochesson faisait parler de lui, de son athlétique constitution, de son inexplicable famélique dans tout le pays soumis à la puissance temporelle de l’illustre chapitre de Remiremont. Mais sa réputation ne pouvait se renfermer dans des limites aussi étroites ; elle transmigra, parcourut toute la Lorraine et parvint jusqu’à la cour de Lunéville où elle surprit les gentilshommes de Stanislas et le roi de Pologne lui-même à tel point, que ce prince voulut voir, de ses propres yeux, ce phénomène de taille, de vigueur et de gloutonnerie.
Le montagnard reçut donc un jour un message du roi qui lui mandait de venir le trouver dans son château de Lunéville. Ce message, que lui lut le magister de Rochesson, le jeta dans un grand étonnement, car il ne savait et ne pouvait deviner ce qui lui valait l’honneur d’être appelé à la cour de Stanislas. Il se mit toutefois en devoir d’obéir à l’ordre de son souverain, et par une chaude matinée d’été, un large feutre sur la tête, une veste de bure sur le dos, des sabots aux pieds, un bâton à la main, Jacques quitta le foyer paternel, descendit le cours de la Moselle et s’achemina vers Lunéville, en passant par Remiremont, Épinal et Charmes. Il arriva à sa destination le 2 juillet 1751. Sa présence confirma tout le merveilleux qu’on disait de lui. Le roi prit plaisir à le voir ; il voulut qu’il logeât au château, qu’on l’entourât de soins, et surtout qu’on lui fournit la nourriture la plus abondante et la plus substantielle.
À cette époque, le duc de Lorraine, qui apparemment avait un faible pour les contrastes, avait colligé auprès de lui deux êtres en tout point opposés, un géant et un nain ; le premier était Lambert, l’un de ses valets de pied, haut pour le moins d’une toise de France, et Ferry-Bébé qui avait peine à atteindre le genou du premier. Le valet de pied était vantard ; il disait à qui voulait l’entendre que sa force était aussi prodigieuse que sa taille, et qu’il était homme à broyer dans ses bras le téméraire qui oserait se mesurer avec lui. Et de ce fait, il avait prouvé en maintes occasions toute la puissance de son bras vigoureux.
Les courtisans goûtaient peu la jactance de Lambert, ils souhaitaient vivement que l’occasion se présentât d’abattre son insolente fierté, et furent d’avis de la trouver dans l’arrivée de Jacques. Ils proposèrent donc à Stanislas de rapprocher les deux géants et de les convier à une lutte corps à corps. Cette proposition acceptée, il fut décidé que le combat s’engagerait dans la salle d’armes du château. Indépendamment des seigneurs et dames de la cour, les notables bourgeois de Lunéville furent invités à assister à ce spectacle, auquel il paraissait nécessaire de donner quelque solennité pour en rendre le souvenir plus durable. On avait auparavant obtenu le consentement de Claudon, qui, peu familier avec la langue française, avait eu toutes les peines du monde à comprendre ce qu’on lui demandait ; mais qui, aussitôt qu’il l’eut saisi, avait prononcé avec expression le oui montagnard (io). Quant à Lambert, il n’avait eu garde de refuser cette heureuse occasion d’ajouter à sa gloire et de cueillir de nouveaux lauriers.
Au jour convenu, les deux athlètes se montrèrent devant la noble assemblée, l’un avec bonhomie et modestie, c’était Claudon ; l’autre, avec fierté et suffisance, c’était Lambert. Ils se regardèrent quelques instants de la tête aux pieds ; puis, à un signal donné par un chambellan, ils allaient s’élancer l’un sur l’autre, quand Claudon, se rappelant les usages de son pays, selon lesquels, en pareille occurrence, les deux champions déposaient leurs vêtements pour ne point les déchirer et pour avoir les mouvements plus libre, dit dans son patois à Lambert, revêtu de sa plus riche livrée : Défât tot rouchot (défais ton habit). Lambert en demanda respectueusement la permission à Stanislas, qui lui accorda. Pour Jacques, il se débarrassa sans cérémonie de sa veste de bure. Ces préparatifs terminés, les deux rivaux se saisirent réciproquement à bras le corps, chacun dans le dessein de terrasser son adversaire. Les spectateurs étaient silencieux et attentifs ; jamais, peut-être, ils n’avaient vu de pareils jouteurs ; ils s’attendaient à un combat opiniâtre, à des effets héroïques, à des tours admirables de force et d’adresse ; mais leur espoir fut déçu. La lutte dura à peine quelques minutes. Jacques étreignit Lambert avec une telle vigueur que celui-ci poussa un cri de douleur et demanda grâce. Claudon venait de lui briser une côte.
Les courtisans, satisfaits, entourèrent le vainqueur et le félicitèrent, tandis que le médecin du roi s’assurait que la blessure du vaincu n’était pas mortelle. Stanislas, n’ayant plus d’inquiétudes sur le sort de Lambert, s’approcha à son tour de Claudon qui ne témoignait aucune émotion, le complimenta et lui demanda ce qu’il voulait pour prix de sa victoire. Le héros vosgien réfléchit un instant ; après quoi, obéissant à la voix instinctive de son appétit : Bayez-mi, dit-il, tra secho de févat (donnez-moi trois sacs de fèves). Le prince sourit de cette réponse ; l’assemblée en fit autant, et d’un commun accord, le surnom de Févat fut donné à Jacques Claudon.
Le lendemain de son triomphe, Jacques Févat se mit en route pour retourner dans son pays. Il était devenu subitement le point de mire de la curiosité publique ; elle l’obsédait, le tyrannisait, lui rendait insupportable le séjour de Lunéville. Stanislas, qui s’était empressé de répondre à ses désirs, lui proposa de faire conduire ses trois sacs de fèves jusqu’à son hameau. Jacques s’en défendit de tout son pouvoir, et fit entendre qu’il était assez fort pour se passer de cheval et de voiture et transporter lui-même sur son dos une charge de ce poids. Il pria seulement qu’on l’aidât à la placer sur ses épaules, et d’un pas ferme et assuré, il s’éloigna de Lunéville, escorté du populaire, qui ne pouvait croire qu’il y avait sous le ciel un homme aussi intrépide et aussi robuste. Mais, arrivé à Xermaménil, il fut arrêté par un scrupule de conscience. Le roi, pensa-t-il, m’a bien donné les fèves, mais il ne m’a pas dit s’il me donnait également les sacs. Et pour s’en assurer, Jacques, toujours chargé de son lourd fardeau, rétrograda et se présenta à nouveau devant Stanislas. En le voyant paraître : j’étais sûr, dit le prince, que tu ne pourrais regagner ton village avec trois sacs de fèves sur tes épaules : ta bonne volonté et ta force sont pour cette fois à défaut, mon pauvre Jacques. Je vais mettre une voiture à ta disposition. – Pardon, Sire, répliqua aussitôt Jacques ; si je reviens ici, c’est pour demander si vous m’avez bien tout donné, les fèves et les sacs. – Certainement oui, répondit Stanislas, qui ne put s’empêcher de rire. – Bien obligé, Sire. – Jacques repartit et rentra sans encombre à Rochesson, plus heureux du fruit de sa victoire que fier de la défaite de Lambert.
À quelque temps de là, de joyeux pêcheurs, sortis de Remiremont, étaient réunis sur les bords de la Moselle, auprès du village pittoresque d’Eloyes. Leur pêche avait dépassé leur espoir. Au milieu des poissons, qui, près de mourir, bondissaient pour la dernière fois sur la prairie, on remarquait un monstrueux saumon dont un audacieux plongeur avait découvert la retraite au fond du trou célèbre de l’Anibleu. Il pesait 13 livres ; un des pêcheurs ayant dit qu’il le donnerait à celui qui pourrait le manger d’une seule fois, et un autre ayant parié 20 francs que Jacques Févat, malgré sa gloutonnerie, ne pourrait en venir à bout d’un seul repas, on retourna à Remiremont, en causant des exploits de Jacques et en prédisant au parieur la perte de sa gageure.
Le jour suivant, deux des mêmes pêcheurs se rendirent à Rochesson, ils abordèrent, sans qu’on la leur indiquât, tant elle était connue, la demeure rustique du nouveau Pantagruel. En y entrant, ils trouvèrent Jacques qui mangeait, car il avait toujours faim. Les députés lui annoncèrent qu’on avait pêché pour lui un saumon qui pesait 13 livres, et lui demandèrent s’il se sentait capable de le manger entièrement en une seule fois. Févat répondit avec naïveté qu’il tâcherait de le faire et qu’on pouvait le mettre à l’œuvre le jour même. L’aubaine était trop bonne pour qu’il la laissât échapper. Ravis de cette réponse, les pêcheurs emmenèrent bien vite Jacques ; trois heures après, ils étaient arrivés à Remiremont.
Il n’était bruit dans cette ville que du pari de Laurent. Ses habitants étaient divisés en deux partis : l’un soutenait la gageure, l’autre la combattait. Comme à Lunéville, l’expérience fut publique. Elle se fit dans la plus vaste salle d’une auberge qui porte aujourd’hui l’enseigne au Cheval de Bronze. La haute bourgeoisie avait presque entièrement envahi la salle : c’était tout au plus s’il y avait place pour la table sur laquelle on servit à Jacques Févat le monstrueux enfant de la Moselle qu’il s’était chargé de dévorer, et dont l’art culinaire de l’hôtelier avait su rendre le plus appétissant possible. La population stationnait dans la rue, attendant avec une tumultueuse impatience l’issue d’une épreuve qu’il ne lui était point permis de voir. Le bourdonnement du dehors, les exclamations du dedans ne causèrent pas la plus légère émotion à Jacques, lorsqu’il fut introduit dans la salle du festin ; il concentra toute son attention sur le monstre, s’assit et commença bientôt sa besogne.
Févat dépeça le saumon avec la maladresse d’un glouton peu civilisé ; il le partagea en vingt morceaux de grandeurs inégales, et comme il avait promis de le manger tout entier et qu’il aurait mieux aimé succomber à la tâche que de manquer à sa parole, il se mit à attaquer toutes les parties de l’animal. Ses dents n’épargnèrent rien, pas même les nageoires, les arêtes, les os. Tout devait être déchiré, broyé, englouti, et c’était vraiment chose merveilleuse à voir que la promptitude avec laquelle Jacques se tirait d’affaire. En un clin d’œil la moitié du saumon se perdit dans les profondeurs de son vaste estomac. Mais tout à coup Févat s’arrêta. Cette halte subite fut défavorablement interprétée par les spectateurs ; tous crurent que le téméraire mangeur avait trop compté sur l’énergie et la capacité de ses voies digestives, et déjà on s’apprêtait à la défaite du héros, lorsque celui-ci, qui ressentait un léger embarras gastrique, se hâta de dissiper leur erreur. Il demanda à boire, engloutit d’un seul trait une bouteille de vin, se remit à l’œuvre avec une nouvelle voracité et expédia l’autre moitié du poisson avec une telle netteté, qu’il n’en resta pas une parcelle sur la table. Puis il promena lentement ses regards autour de lui, comme pour chercher une seconde proie : il avait encore faim.
Ce fait extraordinaire de gloutonnerie valut à Févat les applaudissements des hauts bourgeois, et l’admiration du peuple qui voulait le porter en triomphe à Rochesson.
Extrait de l’ouvrage : H. le Vosgien, Voyage dans les Vosges « Célébrités vosgiennes », Mirecourt, Humbert imprimeur-éditeur, 1866. 568 pages.
Cercle Généalogique de Langley Epinal Remiremont
39, rue de la Mairie
88130 LANGLEY
Nous contacter : cgle88@orange.fr
03 29 67 45 56
Site réalisé par cgle, avec le logiciel Muse Adobe